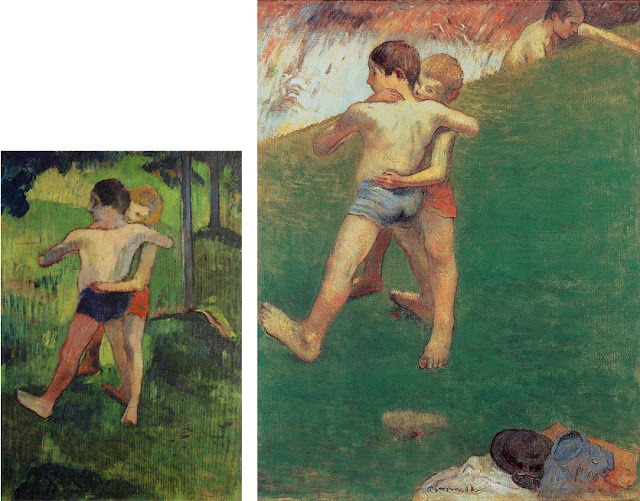Hervé Télémaque
[3]
La plupart des notices
biographiques indiquent que l’œuvre d’Hervé Télémaque aurait évolué depuis la
fin des années 50 jusqu’à aujourd’hui, d’abord marquée par l’Expressionnisme abstrait
américain, puis le pop art ; l’artiste se serait ensuite rapprochée du
mouvement surréaliste avant d’être clairement identifiée comme appartenant à la
figuration narrative et puis, faute d’étiquette esthétique on a fini par se
résoudre à considérer que le terme très général d’autobiographie – mais quelle
grande œuvre ne l’est pas ? - pouvait permettre de classer l’inclassable.
Cette obstination à vouloir ranger les choses ou les gens selon des critères
est assez typique de la logique de l’historien de l’art et que celle-ci soit
bonne ou mauvaise, elle montre toujours ses limites car une œuvre est rarement
une succession de tiroirs. Toute œuvre est la conséquence, ou la réponse aux œuvres
qui ont précédé, passée au filtre de l’histoire intime confrontée à l’histoire collective.
Autrement dit, l’œuvre est inscrite dans des filiations complexes et
subjectives, où le temps présent entre en collusion avec des souvenirs diffus,
des bribes du monde.
Il se trouve que dans le cas
précis d’Hervé Télémaque la conscience aiguë de ce mécanisme ou de ce processus
est le fil tendu qui traverse et définie l’œuvre, la fonde. Cela ne veut pas
dire pour autant que l’œuvre fut programmée, loin de là, car l’artiste a connu
l’incertitude. «J’ai toujours été dans un inconfort qui est devenu presque
confortable – mais ça a mis du temps. » confiait-il récemment. Cet
inconfort n’est pas une incertitude ou un doute quant à la nécessité de faire,
de s’exprimer, mais celui, plus profond, d’une place ou d’une écriture à
trouver qui permette de répondre au plus près aux questions qui l’anime aux
obsessions qui l’habite ; un inconfort certainement social mais aussi
esthétique, celui précisément de ne pas être prisonnier des cases toutes faites,
des attendus, du convenu.
Bien qu’apparemment traversée
d’un point de vue plastique de courants contraires l’œuvre de Télémaque, et ce
depuis le début, est absolument homogène tant par les sujets que par les signes
ou les principes de constructions utilisés. Seule, pourrait-on dire rapidement,
la facture change d’état, tantôt brouillée tantôt nette, tantôt lisse tantôt
âpre, fluide ou stricte puis à nouveau déliée... mais ce qui demeure c’est le
mode d’agrégation des formes, leur façon de glisser l’une vers l’autre, de
jouer de l’équivalence et cela est essentiellement au dessin, qu’il s’agisse de
lignes tracées ou découpées et de masses.
Dès les premiers travaux l’espace
du tableau est envisagé comme lieu d’un dépôt scriptural – comme le serait un
tableau noir d’écolier – où flottent des pictogrammes, des écritures, des
symboles, parfois totalement intelligibles ou partiellement effacés, que
l’usage de la couleur fait parfois basculer due la forme au fond, vient
détacher ou absorber partiellement. Ses peintures sont des ressacs et des
palimpsestes de fragments qui affleurent, se font ou se défont, des liens noués
qui se resserrent sur du lisible qu’il n’est cependant pas toujours possible de
déchiffrer. Ce n’est pas de l’énigme que cherche à produire le peintre par ces
inscriptions partielles ou simplifiées mais bien plutôt l’inverse : tenter
de ramener à la surface de la toile les reliefs d’un fatras, en fixer les contours
ou les structures essentielles, tirer les fils d’une histoire qui n’est d’abord
qu’un problème d’apparence. Télémaque ne défait pas le champ du visible, il ne le
déstructure pas non plus, il l’ordonne, isolant des zones d’interférences, procédant
par extractions, de façon à soumettre, comme sous la lentille d’un microscope,
le tissu du réel à une autre perception. En cela, sa pratique de l’image est
proche de l’écriture poétique.
*
Dessiner, c’est désigner dit-on,
et c’est d’abord par le dessin, soit par l’intention, que s’élabore l’œuvre de
Télémaque. Prenons La Vénus Hottentote (1962). Sur la partie gauche de la feuille se
trouve le dessin d’une figure claire qui se détache sur un fond gris plus ou
moins saturé, fait de hachures amples et en partie gommées. Sur la droite, en
marge et en réserve du dessin, séparée par une ligne visiblement tracée à la
règle, une longue zone étroite et verticale sur laquelle se trouve une suite
d’inscriptions manuscrites (certaines sont biffées) dont : deux dates
(1959-1962), le nom de l’artiste répété trois fois sur la hauteur ainsi que les
termes « hommage à » accompagnés des noms de personnes (des
peintres, des cinéastes de films humoristiques, des femmes…) précédé du;
ajoutons que le titre du dessin est également présent. La figure représentée
est une femme nue, assise ou accroupie, évoquant par ses formes approximatives,
une sorte de poupée : pas de traits pour le visage et les membres, bras ou
jambes, n’ont pas tous des extrémités. De ce corps assez difforme, dont
l’enveloppe est faite d’une succession de lignes en arc de cercle assez
incisives, évoquant des bourrelets de chair ou de graisse, se dégage, comme
ramené vers l’avant de la figure et même presque aplati les courbes d’un
fessier proéminent.
« La Vénus Hottentote ou la Vénus noire»[1],
jeune esclave africaine, fut exhibée en Angleterre puis en France à partir de
1810 comme phénomène de foire pour les particularités de sa morphologie[2] ;
maltraitée et humiliée elle devait décéder prématurément en 1815 ; les
concluions d’analyses des autopsies pratiquées sur sa dépouille par un certain
Cuvier, servirent à nourrir l’idéologie de la supériorité de « la race
blanche » dont un moulage du corps et le squelette de la femme resteront
exposés au Musée de l’Homme, à Paris, jusqu’en 1974. C’est très certainement à
partir d’une des photographies de ce moulage (peut-être une carte postale ?)
que fut exécuté le dessin de Télémaque, dont on comprend, aux assauts rageurs
de la mine de plomb créant des sortes d’entailles sur le corps, et aux coups de
gomme sans ménagement dans les masses grises (quine s’efface jamais vraiment), le
sentiment d’insupportable violence de ce traitement inhumain. Si pour les noms
d’artistes notées en marge ceux de Willem de Kooning (Woman 1950-1952) ou à Peter Saul (Cun Moll, 1961) semblent assez évidents en ce qui concerne la
filiation graphique et la dose d’humour cinglant (ou d’esprit critique),
d’autres, tels Jacques Tati, Charlie Chaplin, les Marx Brother, quoique plus
surprenants, renforcent cependant l’esprit caustique que contient ce dessin.
Enfin, le fait qu’il se rende par trois fois hommage en consignant avec
précision le jour et l’heure d’un évènement antérieur à celui de la réalisation
du dessin laisse à penser que c’est dans
une situation analogue (peut-être humiliante ?) à celle de « La Vénus » que
s’est peut-être trouvé le peintre résidant encore aux États-Unis. Un second
dessin de la même année, reprend ce motif dans un procédé technique identique (Étude pour Vénus Hottentote), mais,
cette fois-ci, le dessin du corps bascule vers la caricature, devenant un sac
affaissé (ou une outre) affublé, en guise de tête, de ce qui ressemble à un
masque africain. L’anatomie schématisée et disloquée de cette figure grotesque
qui gît au sol évoque, plus encore que dans le premier dessin, celui d’une
poupée dont les membres ne seraient plus que moignons ou excroissances
organiques. Sur la partie gauche du dessin un collage, issu d’une publicité (Johnson’s Ultra Wave, un produit pour
lustrer les cheveux) prélevée dans une revue américaine. L’introduction de ce
contrepoint plastique (pure tradition du principe dadaïste ayant inspiré le Pop
Art) augmente l’écart visuel entre l’aspect lisse de la photographe et le
traitement brusque et corrosif de la ligne, tout en affirmant la permanence de
l’utilisation triviale et insidieuse de
l’idéologie raciale (le produit en question permettant entre autre chose de
lisser les cheveux crépus). S’il abandonne l’utilisation du collage pour la
peinture Petite Vénus (1962),
Télémaque conserve néanmoins les bribes des signes élaborés dans son étude,
amplifiant encore la désagrégation du corps : lambeaux flottant dans un
espace éthéré et tourbillonnant en emporte le vent ! pour mémoire, ce
n’est qu’en 2002 que le moulage et le squelette de Sawtche, la dite
« Vénus noire », furent restitués
à l’Afrique du Sud.
Vers le milieu de années 60, le
dessin prendra une place prépondérante dans l’œuvre au dépend de la matière –
celle-ci étant sans doute jugée trop sensuelle pour traiter de questions
politiques ou sociales propres au mouvement de la figuration narrative –.
L’aplat coloré et la ligne neutralisés permettent de répondre aux procédés des
supports dits populaires de la bande dessinée à la publicité. Le dessin sera
alors exclusivement fait de lignes noires d’épaisseur régulière, souvent
introduite dans les compositions par une projection directe à l’épiscope de
documents divers, constituant ainsi par le choix de ce procédé une
uniformisation des sources. De ce procédé naîtront sans doute les formes
épurées de ses premiers volumes (Les
sculptures maigres) usant d’un même vocabulaire que dans les tableaux, assemblage
métamorphiques d’objets du quotidien.
Une autre pratique du dessin
prolongeant ce principe de la ligne claire (« on dit ligne claire mais
elle est noire en réalité », relève Télémaque) sera à partir des années
70 réalisée sur calque en relation avec un travail de papiers collés. Moyen de
prélèvement et de report le calque permet lui aussi mais de façon moins
mécanique que la rétroprojection de simplifier les formes en ne s’attachant
qu’aux zones de contours (y compris pour les zone internes et les ombres). Moyens
courant du dessinateur technique ou de l’architecte, le dessin sur calque
autorise autant la précision que la simplification notamment par reprises
successives ou par superposition des feuilles dessinées qu’autorise la
transparence relative du papier. Délicat et précieux il est l’équivalent dans
le plan de ce que fut la fenêtre d’Alberti pour la représentation de l’espace de
la Renaissance, soit un rabattement de la profondeur en un plan. Télémaque fera
usage de l’ensemble de ces qualités, tantôt dans une phase préparatoire,
isolant et ajustant des formes, tantôt comme double de l’image produite (les
séries des Selles et des Maisons, par exemple) en l’introduisant
en regard d’un collage dans une composition. L’adéquation entre dessin sur
calque et papiers découpés, qui repose sur la notion de gabarit ou de patron
(comme en couture), induit aussi la question du vide et du plein, de la forme
en creux que l’on remplit pour obtenir une surface, et surtout de la nature, de
la texture, ou des couleurs de cette surface ; car si le dessin au calque
est bien une négociation raisonnée de la forme la confection de l’objet elle n’obéit
pas toujours – et pour ainsi dire jamais chez Télémaque – à la couleur locale
de l’objet initial : la multitude de couleurs utilisée pour figurer les
différentes pièces qui constituent une selle de cheval n’est en rien une
déclinaison de la couleur du cuir et ne se veut donc pas réaliste. Autrement
dit, la précision que suppose le calque et qui sert ici d’instrument d’autopsie
du visible n’est pas utilisée pour une restitution rationnelle mais bien pour
une transposition métaphorique de la ligne tracée à la ligne découpée, de
l’affirmation que la représentation est bien un jeu des apparences et que, dans
l’interstice entre où se glisse la manipulation de l’une et de l’autre, l’image
survient en sa transformation.
Aussi étrange que cela puisse
paraître, c’est la réappropriation de ce procédé de dessin considéré comme
froid et neutre qui permet de réintroduire (ou d’intégrer) semble-t-il la
dimension des matières et dans l’œuvre. Des aplats colorés des papiers teintés
dans la masse aux différents motifs des papier à la cuve, il semble donc que
l’univers lisse et glacé des années 70 se laisse à nouveau envahir par d’autres
traitements de surface allant – ou partant – parfois même d’une tache.
Cependant c’est une autre
pratique du dessin introduite au début des années 90 qui ouvre un nouveau champ
de possibles. Contrairement à la pratique de prélèvement et de restitution d’images
collectées que permettait les procédés précédents auxquels il avait
essentiellement eu recours, l’usage du fusain, traité par de larges masses
sombres, fut une façon de faire remonter des images intérieures, mémorisées,
enfouies. Sans doute peut-on attribuer cela autant à la texture charbonneuse et
fragile de l’outil, son poudroiement, qu’au fait que le traitement par masses
denses fait naître des figures quasi fantomatiques, vaguement inquiétantes. Faits
de plans compacts aux contours ciselés comme le sont les sculptures de Arp,
marqués par endroits d’arêtes de lumière nettes - éclairs ouvrant la nuit - qui
laissent deviner la structure de ces figures, ces fusains de grands formats ne
représentent souvent qu’un seul sujet (chauve-souris, jambon, sac pliures de
membres, corps ou paysage), même si, une fois encore, des jeux d’analogies ou
de correspondances entre les différents sujets y sont présents (les plis cassants
d’un sac en papier pouvant par exemple être ceux de la structure des ailes
d’une chauve-souris). Exhumées de la mémoire ces figures ténébreuses, ces « œuvres
au noir » pourrait-on dire, ont indéniablement la valeur de blasons.
Quelques soient, les moyens
mobilisés et les manières, ce qui tient et motive l’œuvre de Télémaque est un
dialogue entre « le visible et le lisible » ainsi que l’exprimait
Merleau-Ponty, une façon modeste mais têtue de déplacer sans cesse les
évidences, de chercher à créer les failles nécessaires qui permettront à
quelques filets d’eau claire de s’infiltrer dans l’opacité des représentations
convenues pour qu’ainsi ils puissent participer à nettoyer notre regard.
![appeau vert [2]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOFh6MgOkcR-ENXoE98H1f9H6zinMky_GO6-oOhGODqMgGEXPP4FDq3kt_VNjfa8m2FttyEIOThIJ3zrWcilJvDskZ_mkYzPfmrD5AaVnnGNV00-Rqp5VMROLXpctN1sZOEFlVF2CwcSE/s1600/DSC06966.jpg)